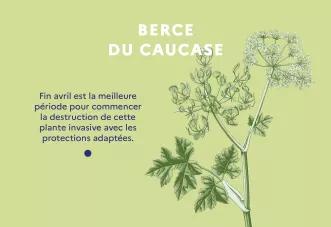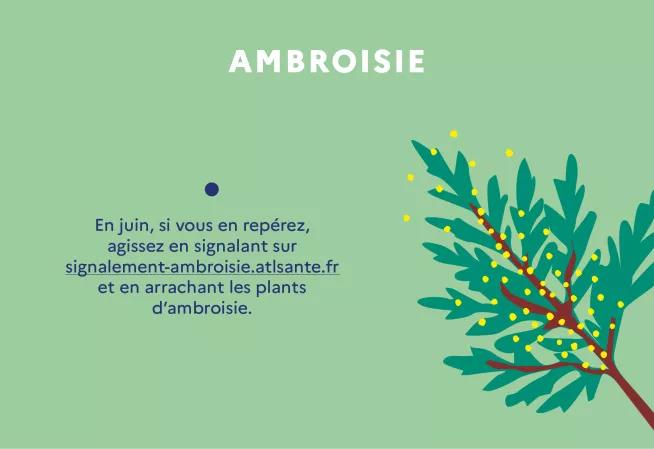Berce du Caucase : ce qu’il faut savoir
La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante herbacée de la famille des Apiacées anciennement appelées Ombellifères en raison de leurs inflorescences caractéristiques en forme d’ombelle.
Originaire du Caucase, elle a été introduite au 19ème siècle en France et en Europe à des fins ornementales.
Plante bisannuelle ou pluriannuelle, elle ne fleurit qu’une seule fois (plante monocarpique) et meurt ensuite.
Sa floraison se situe entre juin et septembre.
La Berce du Caucase préfère les sols frais à humides mais peut s’implanter pratiquement dans tout type de sols. Elle se disperse dans l'environnement et envahit les fossés, les berges de rivière, les bords de route, les lisières forestières, terrain en friche et les prairies extensive. Elle peut former des populations très denses qui prennent le pas sur la flore indigène.
Il s’agit d’une plante toxique devenue invasive au milieu du 20ème siècle dont la prolifération pose aujourd’hui des problèmes environnementaux et de santé publique. Sa sève photo-sensibilisante provoque des irritations et des brûlures sur la peau, après contact.
Comment la reconnaître ?
La Berce du Caucase peut atteindre à la floraison 2m à 3 m de hauteur, voire 5 m. Ses feuilles sont profondément découpées et d’aspect brillant pouvant mesurer entre 0,5 m et 1 m de longueur. Ses tiges florales sont épaisses (de 4 à 10 cm d’épaisseur), creuses et souvent tachetées de pourpre.
Ses fleurs sont blanches, disposées en ombelles de grande taille de 50 cm de diamètre.
Le stade végétatif en détails (avant montée à fleur)

Feuilles alternes divisées en 3 à 5 folioles, profondément découpées et dentées finissant toujours en pointes (très aigues à l’extrémité) ;
Face inférieure des feuilles lisses plus pale que la face supérieure
Tige portant des poils blancs rudes et épars, surtout à la base des tiges foliaires ;
Tiges ayant de nombreuses taches variant de rouge framboise à violet, bien définies et étendues.
Le stade floral en détails :

La plante en fleur peut atteindre 5 m de haut,
Floraison en ombelles de grandes tailles, légèrement convexes .
L’ombelle principale peut atteindre 60 cm de diamètre et comporte entre 50 et 120 rayons (minimum 40 rayons et maximum 170 rayons).
Jusqu’à 8 ombelles secondaires, pouvant dépasser l’ombelle principale
Hauteur : de deux à cinq mètres.
Tige robuste, diamètre 5 à 10 cm, cannelée, creuse, tachetée de pourpre et couverte de poils blancs
Une plante à ne pas confondre avec la berce commune (espèce autochtone)
Il ne faut pas confondre la berce du Caucase avec la berce commune appelée également Berce sphondyle (Heracleum sphondylium L., 1753) . Cette dernière est nettement moins haute et mesure au maximum 2 mètres.
Les feuilles de la berce commune sont généralement plus petites, plus arrondies et plus régulièrement divisées (pennées) que celles de la berce du Caucase. Les tiges sont généralement poilues. La floraison prend forme d’ombelles habituellement beaucoup plus petites que celles de la berce du Caucase, mesurant rarement plus de 20 cm de large, disposant généralement de moins de 30 rayons.

Une plante invasive réglementée par le code de l’environnement
La Berce du Caucase (Heracleum mantegazzanium) est une plante particulièrement invasive. Même s’il lui faut plusieurs années pour fleurir, une plante peut produire 20 000 semences lesquelles peuvent être transportées par l’eau, le vent, les activités humaines et les animaux.
L’espèce est considérée comme naturalisée en France métropolitaine depuis le 19ème siècle et sa population est en phase d’expansion.
Elle est inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne (règlement d’exécution UE du 12 juillet 2017). A ce titre s’appliquent les articles L.411-5 et L.411-6 du Code de l’environnement et l’arrêté interministériel du 14 février 2018 (environnement, agriculture) relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain.
Il est interdit de l’introduire dans le milieu naturel, de la détenir, de la transporter (à l’exception du transport vers des sites de destruction dans le cadre d’une intervention), de l’utiliser, de l’échanger (don, vente, achat).
Berce du Caucase : quels sont les risques pour la santé ?
La berce du Caucase n’est pas seulement problématique pour le milieu naturel et l’agriculture. Elle représente également un danger pour la santé humaine.
En effet, même si le contact avec la sève de la plante ne provoque pas de douleur, la sève contient des toxines (furanocoumarines) qui engendrent des photo-phytodermatites après contact avec la peau ou les muqueuses des humains (et autres mammifères). Celles-ci apparaissent dès 15 minutes après exposition des organes ayant été en contact avec la plante aux rayons ultra-violets du soleil.
Les premiers symptômes se poursuivent par des brûlures cutanées apparaissant entre un et trois jours après le contact avec la sève et pouvant être du premier, deuxième voire troisième degré.
Les symptômes visibles sont les suivants :
Une peau rouge et gonflée ;
L'apparition d’ampoules étendues et suintantes, parfois nombreuses (diamètre pouvant atteindre plusieurs centimètres) ;
L'apparence d’une brûlure, parfois sérieuse (2e degré) ;
NB : La zone cutanée atteinte peut rester sensible aux rayons ultraviolets (photosensibilisation) pendant plusieurs années. Des taches brunes (hyper ou hypopigmentation) peuvent également apparaître sur les zones touchées et persister pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Berce du Caucase : que faire en cas d’exposition ?
Si vous avez été en contact avec la sève de la plante, veillez à :
Laver soigneusement la peau à l’eau froide et à l’aide d’un savon doux.
Éviter toute exposition de la zone concernée au soleil pendant plusieurs jours.
Surveiller l’apparition de réactions ;
Si le contact concerne une importante zone ou particulièrement vulnérable (ex. muqueuses oculaires), consultez un médecin ;
Si un enfant est atteint, consultez sans tarder un médecin ou contactez le centre antipoison pour tout conseil approprié.
Centre anti-poison de Lyon : 04 72 11 69 11.
Berce du Caucase : conseils à appliquer pour se protéger lors de l’élimination de la plante
Toutes les parties de la Berce du Caucase sont toxiques. Il ne faut donc toucher aucune partie de la plante à main nue.
Lors d’une intervention sur la plante, il est indispensable de se protéger de tout contact avec la sève et être attentifs aux projections de gouttelettes qui peuvent imprégner les vêtements et les gants :
Couvrir toutes les parties du corps par des habits protecteurs non absorbants (pantalons longs, manches longues et gants à manchons longs) ;
Éviter tout geste machinal de contact avec le visage ;
Enlever les vêtements et les gants en les retournant à l'envers afin d’éviter tout contact avec la sève déposée, et, bien les laver ;
Protéger les yeux ou tout le visage (visière) des possibles projections de sève ;
Laver les outils en contact avec la sève de la plante.
Il faut également s’assurer que personne ne se trouve dans un rayon où il pourrait être atteint par des gouttes de sève ou des débris de plante ;
Berce du Caucase : bons réflexes pour lutter contre cette plante envahissante et toxique
Lorsque la présence de Berce du Caucase est observée, il faut contrôler son développement et limiter sa propagation en veillant particulièrement à :
Détruire les plants identifiés (en vous protégeant), surtout s'ils se trouvent à proximité d’un lieu fréquenté par le public et en particulier par des enfants.
Eliminer les plantes situées en bord de fossés ou cours d’eau afin de limiter la dispersion des graines par l’écoulement de l’eau.
La réduction d’une population importante de berce du Caucase nécessite un engagement à long terme.
La meilleure période pour éliminer la plante jeune se situe à la fin du mois d’avril ou début mai quand elle mesure moins de 30 cm de hauteur. C’est le moment où il est le plus facile d’arracher (ou éventuellement de sarcler sous le collet) les jeunes plantes.
Quand l’arrachage n’est pas possible (pieds âgés trop enracinés), les racines doivent être sectionnées, le plus bas possible entre 20 et 25 cm en dessous du niveau du sol (en dessous du collet, au printemps dans la mesure du possible, pour éviter toute repousse voire fleurissement.
La coupe sous le collet doit alors être pratiquée à l’aide d’un outil à main, de types bêche, pioche, ou houe.
NB : En cas d’arrachage ou coupe sous collet en zone densement infestée, l’intervention doit être répétée sous 3 semaines pour éliminer les pieds oubliés et les éventuelles plantules initiées par la mise en lumière du sol.
L’arrachage et la coupe sous collet sont les méthodes à privilégier.
A défaut, une coupe répétée de la partie aérienne est aussi possible, par l’utilisation d’une serpe emmanchée, d’une faucheuse ou d’un broyeur sur tracteur. Cette méthode n’est pas définitive, elle doit être répétée jusqu'à épuisement des racines. Une plante affaiblie pourra être plus facilement arrachée ou coupée sous collet.
Pour ces opérations, il convient d’éviter les machines exposant les opérateurs aux projections de débris de plantes et de sève, telles que, notamment, débroussailleuses à fil ou à lame ;
A la fin de l’été, lorsqu’une intervention sur les racines n’est pas possible, il est essentiel de prévoir à minima, la suppression des ombelles afin de limiter la formation de graines et ne pas enrichir la banque de semences du sol. Quel que soit le stade de maturité (en fleurs ou en graines), les ombelles doivent être mises en sac poubelle étanche. Avant formation des fleurs, l’épis floral peut être laissé sur place.
Les graines de berce du Caucase ont une durée de vie de moins de 10 ans et germeront massivement les premières années après production. Une zone de présence de berce du Caucase doit faire l’objet d’un suivi sur plusieurs années après l’élimination des premières plantes (risque de repousses, levée de nouvelles plantes à partir des graines du sol, etc.…).
L’utilisation d’herbicide est à proscrire.
Destruction et conditionnement des déchets verts produits
Les parties de plantes coupées sont des déchets verts. Leur brulage est interdit.
Leur élimination ne doit ni exposer les personnes qui les manipuleront, ni contribuer à la dispersion des graines.
Si la partie aérienne de la plante a été coupée avant floraison, celle-ci peut être compostée, méthanisée ou laissée sur place.
Si la partie aérienne de la plante a été coupée après la floraison, il est possible de prélever les inflorescences et de les placer dans un sac poubelle hermétiquement fermé avant de les diriger vers un centre d’incinération d’ordures ménagères contrôlée, pour éviter toute dissémination des graines.
Il est préférable de laisser sécher les plantes coupées ou arrachées avant élimination afin de s’assurer de sa non-repousse (bouturage, reprise sur racine).