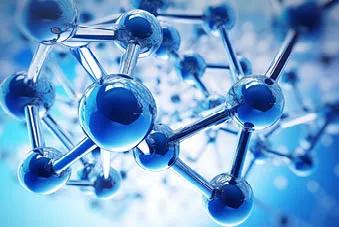Etudes d’imprégnation de la population aux PFAS
L’objectif de ces études est de produire des valeurs de référence d’exposition pour la population française.
Le niveau d’imprégnation de la population française a été mesuré par l’étude Esteban publiée en 2019 par Santé publique France.
Elle a été réalisée sur un échantillon de 744 adultes (18-74 ans) et 249 enfants (6-17 ans) durant deux ans (2014 à 2016). 17 PFAS étaient recherchés.
Les résultats ont montré que 7 étaient régulièrement quantifiés chez les adultes et 6 chez les enfants.
Le PFOA et le PFOS ont été quantifiés à 100 % chez les enfants et les adultes.
Des différences de niveaux d’imprégnation ont été observées selon le sexe, l’âge, l’indice de masse corporelle, la consommation de poissons et des produits de la mer, de légumes, l’autoconsommation d’œufs et de lait, l’utilisation des produits ou matériaux pendant les travaux de loisirs ou de bricolage.
L’enquête Albane, qui prend la suite d’Esteban, actualisera sur l’ensemble du territoire national ces valeurs de référence. Elle sera copilotée par Santé publique France et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). La phase pilote de cette étude nationale commencera en 2024 et le terrain du premier cycle de 2025 à 2026 pour des résultats à partir de 2028 sur le volet biosurveillance.
Concernant les dosages biologiques (prises de sang notamment) des PFAS, ils ne sont pas recommandés car ils ne permettent pas de renseigner sur la source ni la période d’exposition à ces substances.
Par ailleurs, il existe encore des incertitudes quant aux effets cliniques reliés à l’exposition aux PFAS mais surtout, il n’existe pas à l’heure actuelle de seuils qui permettent, sur la base des valeurs d’imprégnation, de définir un risque sanitaire pour la personne et les modalités de prise en charge.
L’exposition des nourrissons
Le passage des PFAS dans le lait maternel est connu et documenté. Les nourrissons peuvent donc être exposés durant la grossesse et l’allaitement. Cependant, les taux d’imprégnation aux PFAS des nourrissons allaités au sein rejoignent, en grandissant, ceux des autres enfants et l’allaitement reste bénéfique (source : Institut fédéral allemand d’évaluation des risques (BfR)).
Conseils pratiques et informations scientifiquement validées, notamment sur la sécurité environnementale et sur la réduction de l’exposition aux perturbateurs endocriniens dont les perfluorés
L’organisation mondiale de la santé (OMS) rappelle que l’allaitement maternel est recommandé de façon exclusive jusqu’à 6 mois et au moins jusqu’à 4 mois pour un bénéfice santé.
Même de plus courte durée, l’allaitement maternel reste toujours recommandé.
Page internet de l’OMS sur l’allaitement
Site internet élaboré par santé publique France destiné aux futurs parents et parents d’enfants de moins de 2 ans
Quelle réglementation pour l’utilisation des PFAS ?
À ce jour, la réglementation, qu’elle soit européenne ou nationale, est ciblée sur quelques substances.
Au niveau européen, le règlement Reach, entré en vigueur en 2007 a pour objectif de sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie européenne. En France, un plan d’actions ministériel sur les PFAS a été élaboré en 2023 dans l’objectif de renforcer la protection des populations et de l’environnement contre les risques liés à ces composés
Réglementation des PFAS au niveau international
La convention de Stockholm de 2001 est un accord international qui réglemente plusieurs composés de la famille des PFAS :
- Depuis 2009, la production et l’utilisation du PFOS sont restreints ;
- Depuis 2020, le PFOA est interdit à l’import, l’export et à la production ;
- Le 7 avril 2022, l’Union européenne prend la décision d’interdire la production et l’utilisation du PFHxS.
Le règlement d’exécution est publié au journal officiel le 8 août 2023. - Le 23 novembre 2022, le PFHxS est ajouté au règlement européen sur les polluants organiques persistants (POP - annexe IV concernant le traitement des déchets)
Le 1er décembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé le PFOA comme « cancérogène pour les humains » (groupe 1) et le PFOS comme substance « peut-être cancérogène pour les humains » (groupe 2B).
Réglementation des PFAS au niveau européen
Le règlement européen REACH vise à sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques en recensant, évaluant et contrôlant les substances chimiques fabriquées, importées et mises sur le marché européen. Toutefois, les polymères (donc certains PFAS) sont actuellement exemptés des processus de REACH. La réglementation REACH est actuellement en cours de révision, cette évolution pourrait être présentée sous forme d’un projet de règlement d’ici fin 2023.
Le règlement POP (polluants organiques persistants) issu de la convention de Stockholm a interdit le PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) depuis 2009, le PFOA (acide perfluorooctanoïque) depuis juillet 2020 et le PFHxS (acide perfluorohexanesulfonique) depuis juin 2022. Les interdictions ou restrictions imposées par le règlement POP peuvent porter sur les substances en tant que telles, ou lorsqu’elles sont sous forme de constituants d’articles, ou incorporées dans des préparations au-dessus de certains seuils.
L’annexe I de la directive européenne EDCH sur les eaux destinées à la consommation humaine du 16 décembre 2020 fixe des teneurs maximales à respecter pour les eaux potables (0,50 μg/l pour le total des PFAS ; ou 0,10 μg/l pour la somme des 20 PFAS substances préoccupantes).
La directive européenne substances prioritaires pour la politique de l’eau, du 12 août 2013, prévoit une norme de qualité environnementale pour le PFOS et ses dérivés.
Le règlement UE 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires fixe des limites d’utilisation (sels d’ammonium du PFOA, PFPoA) ou des limites de migration spécifique (en mg de substance par kg de denrée alimentaire).
Réglementation des PFAS en France
Ces directives et règlements européens sont transposés en droit français, avec notamment :
- l'ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et par ses deux décrets d'application ;
- l’arrêté du 2 février 1998 portant sur les émissions d’une majorité d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à autorisation, qui cite le PFOS en fixant une valeur limite de concentration de 25 µg/l dans les eaux rejetées au milieu naturel ;
- le programme de surveillance de l’état des eaux de la France récemment révisé par l’arrêté du 26 avril 2022 qui intègre pour les eaux souterraines les 20 PFAS listés par la directive EDCH de décembre 2020, et le PFOS pour les eaux de surface.
Un plan d’action ministériel PFAS
En 2022, le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a mené des travaux pour structurer son action au regard des préoccupations grandissantes des PFAS. En janvier 2023, ces travaux ont abouti à la définition d’un plan d’action ministériel sur les PFAS dans l’objectif de renforcer la protection des populations et de l’environnement contre les risques liés à ces composés.
En avril 2024, tout particulièrement pour faire le lien entre les sujets des risques industriels, des impacts sur la santé et sur les milieux, un plan d’action interministériel a été publié. Il intègre et se substitue aux actions prévues dans le plan initial. Le pilotage est attribué à l’ensemble des ministères mobilisés (santé, écologie, industrie, consommation, recherche, agriculture, intérieur, armées, etc.), opérateurs (Ineris, BRGM, Ifremer etc.) et agences (Anses, SpF, Ademe, OFB, Agences de l’eau, etc.).
Les 5 axes d’action du plan interministériel
- Développer des méthodes de mesure des émissions, des contaminations de l’environnement et de l’imprégnation des humains et des autres organismes vivants ;
- Disposer de scénarios robustes d’évaluation d’exposition des organismes (humains et autres organismes vivants) prenant en compte les multiples voies (ingestion, inhalation, contact cutané) et sources d’exposition aux polluants ubiquitaires que sont les PFAS ;
- Renforcer les dispositifs de surveillance des émissions ;
- Réduire les risques liés à l’exposition aux PFAS ; innover en associant les acteurs économiques et soutenir la recherche ;
- Améliorer l’information auprès de la population, pour mieux agir.
Plan d’action interministériel sur les PFAS avril 2024
Quels contrôles des PFAS en Auvergne-Rhône-Alpes ?
Les contrôles de la présence de PFAS concernent plusieurs domaines : l’eau de consommation, les milieux (air, sols, milieu aquatique), les denrées alimentaires, etc.
La surveillance de l’eau de consommation est assurée par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes qui agit pour le compte des Préfets de département. Elle assure le pilotage du contrôle sanitaire de l’eau avec des laboratoires agréés et émets de recommandations en cas de besoin.
La surveillance des denrées alimentaires, notamment celles qui sont commercialisées est assurée par la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et des forêts (DRAAF) Auvergne-Rhône-Alpes.
La surveillance des milieux et sur les sites industriels est assurée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), Auvergne-Rhône-Alpes.
Il s’agit donc d’un travail et d’une coordination interministérielle, assurée par les préfets de département et par la préfète de la région.